L'enfant souffre-douleur
L'intimidation à l'école
de Maria G.R. Robichaud
Critique de Lise Presseault
 Selon
une enquête réalisée par Développement des ressources humaines Canada,
on peut prévoir dans chaque classe du primaire deux garçons et une fille
intimidateurs et un garçon et une fille victimes. Dans une école de 14 classes,
on estime que 70 élèves vivent l'intimidation ou la victimisation
à une intensité différente. Voilà l'ampleur du phénomène décrit par Maria
Robichaud dans L'enfant souffre-douleur. Selon
une enquête réalisée par Développement des ressources humaines Canada,
on peut prévoir dans chaque classe du primaire deux garçons et une fille
intimidateurs et un garçon et une fille victimes. Dans une école de 14 classes,
on estime que 70 élèves vivent l'intimidation ou la victimisation
à une intensité différente. Voilà l'ampleur du phénomène décrit par Maria
Robichaud dans L'enfant souffre-douleur.
Toute école qui veut mettre fin au phénomène de l'intimidation bénéficiera
des ressources proposées par l'auteure. Maria Robichaud nous sensibilise
à l'importance de soutenir l'enfant victime, au fait qu'il ne suffit pas
de concevoir des programmes d'intervention pour les enfants dits intimidateurs.
Être un enfant victime, rejeté ou isolé a des conséquences néfastes puisque
l'appartenance au groupe d'amis et l'approbation des pairs sont très importants
pour les enfants et pour le développement de leurs compétences sociales.
Selon l'auteure, l'«intimidateur et la victime sont des enfants qui, pour
différents motifs, n'ont pas acquis les outils nécessaires à la vie de
groupe, comme l'apprentissage de certaines habiletés sociales, la résistance
à la frustration et le sens de l'humour. Ces enfants ont de la difficulté
à supporter la compétition, à accepter leurs erreurs et à s'affirmer»
(p. 47). Elle propose des programmes et des stratégies pour développer
les compétences sociales chez les enfants et plus particulièrement l'empathie.
Les recherches démontrent que développer l'empathie, l'habileté de se
mettre à la place des autres ainsi que l'autocontrôle, la gestion de la
colère et la résolution de conflits sont des moyens pour prévenir l'intimidation.
Les grandes questions sont traitées en profondeur. Que peut faire
l'école? Que doivent faire les parents d'un enfant victime d'intimidation
ou d'un enfant qui participe à l'intimidation? Que peut faire l'enfant
victime d'intimidation et de victimisation?
L'auteure propose plusieurs programmes qui existent déjà dans d'autres
provinces et qui pourraient certainement inspirer le développement d'un
programme d'intervention dans une école. Certains programmes font la promotion
de comportements pacifiques, dont l'enseignement des compétences sociales
nécessaires à la résolution de conflits; d'autres encouragent la maîtrise
des émotions et le développement de l'empathie qui, selon les recherches,
est un moyen de prévenir l'intimidation.
Les parents qui peuvent observer certains signes indiquant que leur enfant
est victime d'intimidation (enfant qui a peu d'amis, qui préfère la compagnie
d'adultes, qui se plaint de maux de ventre ou de nausées, qui est souvent
mêlé à des batailles) ont également un rôle à jouer. On propose aux parents
de travailler avec l'école à la préparation d'un plan d'intervention et
de stratégies et de comportements favorisant le développement des compétences
sociales de l'enfant.
L'enfant souffre-douleur mérite une lecture sérieuse, car il constitue
un outil susceptible de nous guider dans nos interactions avec les enfants
et les adolescents et de nous aider à poser des gestes concrets pour contrer
l'intimidation et la victimisation dans nos écoles.
L'enfant souffre-douleur : l'intimidation à l'école, Montréal,
Éditions de l'Homme, 2003, 170 pages; ISBN 2-7619-1800-2; 15,95 $.
Ancienne agente de programme à l'Ordre, Lise Presseault est maintenant
à la retraite.
Vivre le conte dans sa classe
Pistes de découverte et exploitations pédagogiques
de Charlotte Guérette et Sylvie Roberge Blanchet
Critique de Véronique Ponce
 Si
vous êtes parfois à court de nouvelles idées d'activités originales qui
favorisent à la fois le plaisir de la lecture et le développement de diverses
compétences, voici l'outil qu'il vous faut. Vivre le conte dans sa
classe propose des activités extrêmement bien pensées et minutieusement
détaillées. Si
vous êtes parfois à court de nouvelles idées d'activités originales qui
favorisent à la fois le plaisir de la lecture et le développement de diverses
compétences, voici l'outil qu'il vous faut. Vivre le conte dans sa
classe propose des activités extrêmement bien pensées et minutieusement
détaillées.
Chacun des six chapitres de l'ouvrage exploite un sujet avec précision
tel que l'historique du conte ou l'art de raconter pour séduire
les enfants. Ces chapitres sont à leur tour divisés en de
nombreuses capsules permettant d'étudier plusieurs aspects des
contes choisis en fonction d'intentions éducatives prédéterminées
: développer la confiance en soi, présenter des règles
de vie, développer la créativité, utiliser son jugement
critique, pour n'en citer que quelques-unes.
Les auteures vous prennent littéralement par la main durant le déroulement
de chaque activité en vous indiquant, par exemple, la meilleure façon
de présenter le conte, le moment de tourner la page, le ton à adopter,
les activités d'échanges et de discussions possibles, la gestuelle et
les chansons pouvant accompagner l'histoire. Elles rappellent les caractéristiques
psychologiques et affectives propres à un certain groupe d'âge (rechercher
la sécurité, avoir peur de l'inconnu, contrôler la situation, etc.)
L'ouvrage est une source précieuse de renseignements bibliographiques
et d'exploitations pédagogiques. On y trouve même une liste
des liens possibles entre les contes des capsules et d'autres disciplines
comme l'enseignement moral, les arts plastiques, la science et la technologie.
Et bien qu'il établisse des liens avec le programme de formation
de l'école québécoise, les éducateurs du préscolaire
et du primaire de l'Ontario y trouveront suffisamment de matériel
et d'idées pour le restant de leur carrière.
Vivre le conte dans sa classe : pistes de découverte et exploitations
pédagogiques, coll. Parcours pédagogiques, Montréal, Éditions Hurtubise
HMH, 2003, 222 pages; ISBN 2-89428-619-8; 32,95 $.
Véronique Ponce est traductrice-réviseure à l'Ordre.
Des idées fraîches à l'école
Activités et projets pour contrer les changements climatiques
Sous la dir. de Tim Grant et Gail Littlejohn
Critique de Pierre Drouin
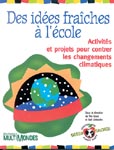 Sensibiliser
les jeunes à la problématique des changements climatiques est un défi
d'envergure. À cet égard, Des idées fraîches à l'école facilite
la tâche de l'enseignant. Sensibiliser
les jeunes à la problématique des changements climatiques est un défi
d'envergure. À cet égard, Des idées fraîches à l'école facilite
la tâche de l'enseignant.
Regroupés par thèmes, les articles de 2 à 5 pages du recueil
présentent chacun un aspect théorique des changements climatiques et des
activités pratiques faisant appel au sens d'observation et à l'esprit
cri-tique des élèves. Des idées fraîches à l'école compte des activités,
des projets et de simples outils pédagogiques facilement utilisables par
les jeunes des paliers élémentaire et secondaire sur la bio-diversité,
l'agriculture, la croissance démographique, l'effet de serre, le transport,
les choix énergétiques, etc. On y décrit, entre autres, des expériences
sur les propriétés des gaz et sur l'emmagasinage de l'électricité, on
propose un sondage sur le transport, on examine le coût réel des véhicules,
on explique comment faire son propre beurre d'arachides et fabriquer un
four solaire.
On y énumère également plusieurs ressources, dont une liste d'organismes
prêts à fournir un appui dans des domaines pertinents (environnement,
efficacité énergétique, transports alternatifs), une bibliographie ainsi
qu'une liste de sites Internet. Un tableau des activités classées par
groupes d'âges (5-8, 9-11, 12-14, 15-17) offre des liens multidisciplinaires
(science et technologie, mathématiques, français, arts plastiques, géographie,
art dramatique).
Des idées fraîches à l'école est une ressource sur un sujet d'actualité
qui regorge d'activités et de sujets de recherche qui ne manqueront pas
de piquer la curiosité naturelle des élèves en les invitant à poser des
questions, à examiner l'impact de certaines pratiques actuelles sur l'environnement
et à trouver des solutions de rechange.
Des idées fraîches à l'école : activités et projets pour contrer les
changements climatiques, traduit et adapté par ERE Éducation, Toronto,
Éditions Multimondes et Green Teacher, 2001, 80 pages; ISBN 2-89544-017-4;
15,95 $.
Pierre Drouin enseigne à temps partiel à la Faculté d'éducation de
l'Université d'Ottawa.
Lire et écrire
en première année et pour le reste de sa vie
d'Yves Nadon
Critique d'Helen Donohoe
 Véritable
cri du cœur, le texte d'Yves Nadon, enseignant de 1re année au Québec,
présente en détail le processus de lecture et d'écriture des élèves du
primaire. On y trouve un magnifique équilibre entre une écriture passionnée
et une pédagogie des plus pratiques. Véritable
cri du cœur, le texte d'Yves Nadon, enseignant de 1re année au Québec,
présente en détail le processus de lecture et d'écriture des élèves du
primaire. On y trouve un magnifique équilibre entre une écriture passionnée
et une pédagogie des plus pratiques.
La majeure partie du livre, qui est consacrée au mécanisme d'incitation
à la lecture et à l'écriture à utiliser avec les jeunes enfants, contient
une mine d'idées et d'observations. Et chacune d'entre elles peut être
appliquée en classe. De nombreux exemples montrent comment les élèves
progressent de septembre à juin. Yves Nadon fait également une analyse
méticuleuse de textes d'enfants dont la portée est universelle.
Il est à la fois intéressant et encourageant de constater que nombre
d'approches contemporaines par rapport à la lecture (p. ex., lecture dirigée
et lecture partagée) et des outils diagnostiques créés par l'éducatrice
néo-zélandaise Marie Clay sont utilisés régulièrement dans d'autres régions
du pays. Le processus élaboré par Yves Nadon pour discuter avec les élèves
de leurs progrès est particulièrement bien décrit.
Dans le dernier chapitre, M. Nadon présente quelques-unes de ses
propres méthodes d'évaluation, mais ne les rattache pas
à un système de notes en chiffres ou en lettres. Il s'agit
là de la seule faiblesse de cet ouvrage extrêmement pratique
pour l'enseignant du primaire dans une école de langue française
ou d'immersion.
La bibliographie très complète à la fin de chaque
chapitre (la plupart des textes sont en anglais) permet au lecteur d'agrandir
son champ de connaissances, tandis que les annexes contiennent des idées
et des tableaux de vérification et d'évaluation utiles.
Lire et écrire, en première année et pour le reste de sa vie,
Montréal, Chenelière-McGraw-Hill, 2002, 184 pages; ISBN 2-89461-928-6;
32,95 $; 514-273-1066; téléc. 514-276-0324.
Helen Donohoe est une enseignante de français à la retraite qui travaillait
au conseil scolaire du district d'Hamilton-Wentworth.
Collection En Rappel
Cahiers d'exercices sur le français et les mathématiques
Critique de Pierre Drouin
 Ces
cahiers ont pour cible l'élève du cycle moyen ou intermédiaire qui a besoin
de revoir et d'intégrer les notions de base du français et des mathématiques.
Il ne s'agit pas de manuels de classe au sens strict du mot, mais d'une
trousse pédagogique et d'appui à l'apprentissage comportant des exercices
structurés sur des sujets précis (comme la conjugaison des verbes, les
fractions équivalentes, les longueurs). Ces
cahiers ont pour cible l'élève du cycle moyen ou intermédiaire qui a besoin
de revoir et d'intégrer les notions de base du français et des mathématiques.
Il ne s'agit pas de manuels de classe au sens strict du mot, mais d'une
trousse pédagogique et d'appui à l'apprentissage comportant des exercices
structurés sur des sujets précis (comme la conjugaison des verbes, les
fractions équivalentes, les longueurs).
On y trouve des exercices de rattrapage et de renforcement qui s'intègrent
bien dans le contexte de l'évaluation diagnostique et permettent
à l'élève de combler ses lacunes. Il est donc normal
que les cahiers ne présentent que les éléments essentiels
des divers thèmes.
Les exercices se limitent au niveau taxonomique des connaissances, laissant
peu de place à la créativité ou à une approche
différente de la part de l'élève. L'objectif étant
la maîtrise des notions de base, on résume les faits importants,
on décortique les étapes d'un processus et on présente
des aide-mémoire facilitant le rappel des règles. Enfin,
on propose de simples exercices axés sur les notions de base et
présentés de façon progressive. L'élève
peut les compléter à son propre rythme avec un minimum de
directives et de suivi de la part de l'enseignant.
Une étude plus approfondie de la trousse permet cependant de déceler
des erreurs dans les corrigés mathématiques, des questions
dont la réponse est trop évidente et des réponses
uniques à des questions ouvertes.
L'accord du verbe avec son sujet, Les participes passés, La mesure,
Les fractions, Les nombres décimaux et les pourcentages, coll. En
Rappel!, Montréal, Marcel Didier, 2002, 32 pages; ISBN 2-89144-350-0,
2-89144-349-7, 2-89144-364-0 et 2-89144-362-4; distribution au Canada
: Éditions Hurtubise HMH.
Pierre Drouin enseigne à temps partiel à la Faculté d'éducation de
l'Université d'Ottawa.
The Primal Teen
What the New Discoveries About the Teenage Brain Tell Us About Our Kids
de Barbara Strauch
Critique de Michael Reist
 Les
adolescents ne sont pas des paresseux. En fait, ce sont les membres de
la société qui manquent le plus de sommeil! En plus de croître sans cesse,
ils se lèvent à 6 h du matin pour prendre l'autobus, travaillent
jusqu'à 11 h du soir au MacDo et ne se couchent pas avant minuit. Les
adolescents ne sont pas des paresseux. En fait, ce sont les membres de
la société qui manquent le plus de sommeil! En plus de croître sans cesse,
ils se lèvent à 6 h du matin pour prendre l'autobus, travaillent
jusqu'à 11 h du soir au MacDo et ne se couchent pas avant minuit.
Pourtant, les recherches indiquent que les adolescents ont besoin de
neuf heures de sommeil, c'est-à-dire davantage que les adultes
et les plus jeunes, et que leur horloge biologique est programmée
pour qu'ils se couchent tard et se lèvent tard. Les écoles
qui ont fait l'essai des classes débutant plus tard rapportent
un meilleur rendement scolaire et moins de problèmes de comportement.
Barbara Strauch présente une variété de découvertes récentes et pertinentes
au sujet du cerveau de l'adolescent, qui sont d'importance capitale pour
les parents et les enseignants.
Par exemple, les chercheurs ont découvert que la tendance des
adolescents à courir des risques est d'origine chimique. Les sensations
fortes libèrent de la dopamine, dont le niveau est bas chez l'adolescent,
ce qui déclenche un sentiment de bien-être. En outre, les
lobes frontaux du cerveau, auxquels sont associés le jugement et
la planification, font l'objet d'une restructuration qui débute
à la puberté et ne se termine qu'à l'âge de
20 ans. Un bolide sans freins!
Strauch fait remarquer que les parents et les enseignants doivent aider
les adolescents à connaître leurs limites, à jouer
le rôle des lobes frontaux pour eux, comme elle dit. Plusieurs chercheurs
recommandent que les adolescents courent davantage de risques calculés,
qu'on les amène à affronter le danger d'une façon
constructive plutôt que de les laisser conduire dangereusement ou
abuser des drogues et de l'alcool.
L'un des plus grands changements dans le développement des adolescents
est le passage de la pensée concrète à la pensée
abstraite. Strauch cite des enseignants de mathématiques qui parlent
de jeunes qui comprennent enfin. Des chercheurs situent le seuil du changement
à 17 ans et j'ai constaté le même phénomène
dans mes cours d'anglais.
Les adolescents arrivent enfin à discerner les thèmes et
le sens que recèlent les événements concrets de l'intrigue.
Les filles développent certainement cette capacité plus
tôt que les garçons.
Ce qui porte à se demander si nous testons des choses que bien
des élèves ne peuvent pas apprendre. Et si les tests actuels
de 10e année désavantageaient toujours les garçons?
Strauch insiste sur le fait qu'il ne faut pas considérer l'adolescence
comme étant une maladie à guérir ou un problème
à résoudre. De telles découvertes peuvent cependant
engendrer une meilleure compréhension des adolescents et améliorer
nos communications avec eux, c'est-à-dire nous aider à leur
donner ce dont ils ont vraiment besoin.
The Primal Teen, Doubleday / Random House, 2003, 242 pages;
ISBN 0-385-50339-3; 37,95 $; 410-848-1900 ou 1-800-726-0600;
www.randomhouse.com.
Michael Reist est chef de la section d'anglais à l'école secondaire
catholique Robert-Hall de Caledon Est.
The Skin That We Speak
Thoughts on Language and Culture in the Classroom
Sous la dir. de Lisa Delpit et Joanne Kilgour Dowdy
Critique de Marguerite Alfred
 Dans
son introduction, Lisa Delpit écrit : Comme la peau qui facilite nos interactions
avec le monde, tant dans notre façon de percevoir notre environnement
que dans la perception des autres à notre égard, la langue joue un rôle
identitaire essentiel : il s'agit du langage de notre peau. Dans
son introduction, Lisa Delpit écrit : Comme la peau qui facilite nos interactions
avec le monde, tant dans notre façon de percevoir notre environnement
que dans la perception des autres à notre égard, la langue joue un rôle
identitaire essentiel : il s'agit du langage de notre peau.
Cet ouvrage est fascinant à lire. Il présente des essais percutants reposant
sur l'hypothèse que les éducateurs contribueraient à la marginalisation
des jeunes en ignorant l'intersection de la langue et de la culture dans
la salle de classe. La convention tacite que l'anglais standard est la
seule forme valide ajoute à l'aliénation et au sentiment d'infériorité
des enfants minoritaires. Elle a également pour effet d'empêcher les enfants
du groupe principal de profiter de la richesse des autres cultures qui
s'expriment dans d'autres dialectes de la langue anglaise.
Composé de trois sections, l'ouvrage débute par deux comptes
rendus d'expériences bien personnelles vécues par les auteurs.
La première est celle d'une universitaire antillaise qui décrit
l'adoption de l'anglais britannique par sa famille à Trinidad et
comment cette décision l'a marginalisée par rapport à
ses compatriotes. L'autre porte sur l'argot parlé par des Noirs
américains des milieux défavorisés. Les deux visent
à nous sensibiliser à la langue que les enfants amènent
en classe.
La deuxième section illustre comment la langue utilisée en classe doit
valoriser les élèves. Lorsque nous tentons d'enseigner les formes habituelles
de l'anglais, nous devons leur faire voir que nous respectons et valorisons
la langue qu'ils amènent de la maison. Il faut que les enseignants acceptent
d'aider les élèves à développer la capacité de passer aisément de la culture
de l'école à celle de la maison. Cette capacité agrandira le champ de
leurs relations avec la société, car la culture de l'école a pour objet
principal de faire connaître les mœurs et valeurs de toute la société.
Dans le dernier article, une révélation émouvante
illustre pourquoi certains élèves sont réduits au
silence. Le titre de l'essai de Joan Wynne «On parle mal. Demandez
à lui.» lui est venu après qu'elle ait été
témoin lors d'une réunion publique de la tendance des parents
minoritaires à ne pas parler parce que leur langue, la forme d'anglais
qu'ils parlent, n'était pas assez bonne.
Tous les essais attestent fermement de la nécessité de reconnaître que
l'enseignement du dialecte standard de l'anglais doit se faire dans le
respect des nombreuses langues que nous parlons parce qu'elles signifient
qui nous sommes. Dans une société de plus en plus ethnique, ce genre de
discussion doit primer dans notre esprit. Nous devons essayer de créer
des écoles qui favorisent la pensée critique des enfants afin qu'ils respectent
et valorisent la contribution de tous les peuples.
The Skin That We Speak: Thoughts on Language and Culture in the Classroom,
New York, The New Press, 2003; ISBN 1-56584-820-9; 229 pages, 16,95 $;
212-629-8802; téléc. : 212-629-8617; www.thenewpress.com.
Marguerite Alfred est directrice adjointe de l'école publique St.
Margaret's à Toronto.
|

